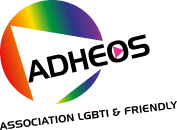Au lycée, mes parents m’ont fait suivre une thérapie pour que j’arrête d’aimer les garçons. Elle a bien failli me tuer
C’est arrivé au début de ma première année de lycée. Alors que je rentrais à la maison, j’ai trouvé ma mère en train de pleurer, assise sur son lit. Elle avait fouillé dans mes e-mails et était tombée sur un message dans lequel je confessais avoir un faible pour un de mes camarades de classe.
« Est-ce que tu es homo ? », m’a-t-elle demandé. Je lui avouais que oui. « Je le sais depuis que tu es petit garçon. » Mais elle ne s’est pas résignée bien longtemps – confrontée à un problème, ma mère ne se démonte pas et se met aussitôt à le résoudre.
Dès le lendemain, elle me tendait une pile de documents imprimés, trouvés sur le Web, à propos de la « réorientation » sexuelle et des remèdes pour soigner l’homosexualité. Je les ai jetés par terre. Je lui ai dit que je ne voyais pas comment parler de moi à un thérapeute allait m’empêcher d’aimer les garçon
« Les gays ont un mode de vie solitaire »
Ma mère m’a alors demandé si je souhaitais fonder une famille un jour, et puis m’a posé cette question : « S’il existait une pilule qui pourrait te rendre hétéro, est-ce que tu la prendrais ? » J’ai admis que les choses seraient plus simples si une telle pilule existait.
Jusque là, je n’avais jamais réfléchi aux implications que mon attrait pour les garçons allait avoir sur le reste de ma vie. En fait, je m’étais toujours imaginé, arrivé à l’âge de 40 ans, marié à une femme, avec un fils et une fille – mais c’est le cas pour tout le monde, non ? « Les homosexuels ont un mode de vie très solitaire », m’a-t-elle dit. Et puis elle m’a parlé du docteur Joseph Nicolosi, un psychologue clinicien en Californie, alors président de la National Association for Research and Therapy of Homosexuality (Narth, « société nationale pour l’étude et la thérapie de l’homosexualité »).
C’est le plus grand groupe de médecins pratiquant ce type de traitements. Elle m’a expliqué que Nicolosi avait aidé des centaines de personnes, qui pouvaient désormais mener des vies « normales ».
J’ai fini par lire les papiers que ma mère avait récupérés dans la poubelle. C’étaient des entretiens avec des patients de Nicolosi, qui expliquaient comment la thérapie les avaient aidés à surmonter la dépression et à se sentir « à l’aise avec leur masculinité ».
Ces témoignages semblaient authentiques, et les patients, reconnaissants. J’ai accepté de partir de notre petite ville, près de la frontière entre le Mexique et l’Arizona, et d’aller à Los Angeles avec mon père pour une première consultation avec ce thérapeute.
Brusque mais affable, le psy m’a mis à l’aise
La clinique de psychologie Thomas-Aquinas se trouvait au treizième niveau d’un immeuble récent de Ventura Boulevard, une des artères de la San Fernando Valley. Au coin de l’étage, le bureau de Nicolosi était décoré d’un tapis vert émeraude et des étagères en acajou alignaient des livres avec des titres comme « Homosexuality : A Freedom Too Far » (« Homosexualité : quand la liberté va trop loin ») ou « Homosexuality and the Politics of Truth » (« Dire la vérité sur l’homosexualité »).
La quarantaine, les cheveux bruns épais et grisonnants, Nicolosi, qui a grandi à New York, parlait avec un léger accent du Bronx. Brusque mais affable, il m’a mis à l’aise.
Une fois assis, Nicolosi nous a expliqué en quoi consistait son « remède ». Même si je ne ressentirais sans doute jamais un frisson d’excitation en voyant une femme marcher dans la rue, en progressant dans la thérapie, mes pulsions homosexuelles diminueraient. Je serais sans doute encore attiré par les hommes, mais ces envies ne me contrôleraient plus.
Le fait qu’il reconnaisse que le changement ne serait pas total a rendu sa théorie plus crédible à mes yeux. Sa confiance dans une issue positive m’a donné de l’espoir. Avant de parler avec lui, je m’étais résigné à rester homo toute ma vie, que cette idée me plaise ou non. Mais peut-être que je pouvais décider, et non plus subir ?
Lors de la deuxième partie de la séance, je suis resté seul avec Nicolosi. « Parlez-moi de vos amis à l’école », m’a-t-il demandé. Je lui ai répondu que j’avais deux amies proches. « Et des amis masculins ? » J’ai admis que j’avais du mal à me lier avec des garçons de mon âge. Quand j’étais en primaire, je préférais aider le prof à nettoyer la classe plutôt que faire du sport pendant la récréation.
Si c’était ça, être homo…
« Est-ce que tu es prêt à commencer une thérapie ? », m’a demandé Nicolosi. « Si tu penses que ça ne marche pas, tu peux arrêter quand tu veux. » J’étais d’accord pour commencer des séances hebdomadaires par téléphone.
Après cet échange seul à seul, j’ai rejoint d’autres patients pour une thérapie de groupe. J’étais de loin le plus jeune. Les autres, quatre ou cinq en tout, avaient entre 40 et 60 ans, et parlaient de leurs années passées à suivre « le mode de vie homo », ce qui n’avait fait que les rendre malheureux.
Ils voulaient des vies normales, accomplies. Ils en avaient assez de fréquenter les discothèques, de prendre de la drogue, de multiplier les partenaires ou d’entamer des relations amoureuses qui ne durent jamais. Ils se plaignaient de l’obsession de la jeunesse qui imprègnait la culture gay. Si c’était ça, être homo (et comme ils avaient trente ans ou plus d’expérience, je leur faisais confiance à ce sujet), alors moi aussi je voulais être normal.
J’ai quitté le bureau avec un exemplaire du livre de Nicolosi le plus récent, Healing Homosexuality (« Soigner l’homosexualité ») et une brochure qui répartissait différentes émotions entre deux rubriques : le « vrai moi » et le « faux moi ».
Le vrai moi se sentait masculin, était « satisfait, à la hauteur », « en sécurité, confiant, capable » et « à l’aise dans son corps ». Le faux moi ne se sentait pas masculin, était frustré et mal assuré, et ne se sentait pas en phase avec son propre corps.
Ce discours sonnait juste : on s’était moqué de moi pendant toute mon enfance parce que j’étais efféminé ; adolescent dégingandé et maladroit, affligé de problèmes de peau, je n’étais certainement pas en phase avec mon corps.
« La preuve que la vérité peut vous libérer »
Un autre document montrait la « relation triadique » qui mène à l’homosexualité : un père absent et passif, une mère surimpliquée, un enfant sensible. J’étais plus proche de ma mère que de mon père, j’étais timide. L’ensemble semblait coller, ce qui m’a rassuré et m’a conforté dans l’idée que je pouvais être guéri.
Selon Nicolosi, l’identification avec un parent de l’autre sexe est en contradiction avec notre identité biologique et notre évolution en tant qu’adulte. A cause de ça, il était impossible de se sentir un être à part entière en ayant des relations homosexuelles. Je voulais devenir un être à part entière.
Le 13 juillet 1998 – année où j’ai commencé la thérapie – une pleine page de pub est parue dans le New York Times, montrant une dame rayonnante arborant une bague de fiançailles et une alliance. « Je suis la preuve que la vérité peut vous libérer », clamait-elle. Cette femme, Anne Paulk, expliquait que des violences pendant son adolescence l’avaient conduite à devenir homosexuelle, mais qu’elle était désormais guérie grâce à la puissance de Jésus Christ.
Cette campagne de pub a coûté 600 000 dollars. Elle avait été payée par quinze organisations de la droite religieuse, dont la Christian Coalition, le Family Research Council et l’American Family Association. Sa diffusion a duré plusieurs semaines, dans des journaux comme le Washington Post, USA Today et le Los Angeles Times. Robert Knight, du Family Research Council, a comparé cette opération à un « débarquement de Normandie » dans la « guerre des cultures » qu’ils étaient en train de mener.
Des journalistes ont fait de ces témoignages (peu d’entre eux ont pris la peine de les vérifier) le signe d’une nouvelle tendance. Newsweek a fait sa couverture sur les thérapies du changement, présentées de façon bienveillante. Des titres régionaux et nationaux ont publié des récits d’anciens gays. Ma mère n’aurait peut-être pas pu trouver si facilement des informations sur ces traitements si la droite chrétienne n’avait pas aussi bien préparé le terrain.
Derrière ces pubs, un coup bien mené
Cette offensive a été lancée vingt-trois ans après que l’American Psychiatric Association (APA, société américaine de psychiatrie) a retiré l’homosexualité de la liste des maladies mentales. Des formes extrêmes de réorientation sexuelle avaient alors été abandonnées, comme des séances d’électrochoc ou la prise de médicaments déclenchant des nausées.
Un petit groupe de médecins continuait cependant de pratiquer des thérapies par la parole en incitant les patients à voir l’homosexualité comme un trouble du développement. Ces méthodes sont cependant restées marginales jusqu’à ce que la droite chrétienne en fasse la promotion.
C’était là un coup politique bien mené : au lieu de promettre aux homosexuels des châtiments apocalyptiques depuis les chaires des églises, on montrait de la compassion pour eux. Focus on the Family a ainsi intitulé son initiative pour dépasser l’homosexualité Love Won Out (« l’amour a gagné »), et expliqué qu’il fallait prendre soin des homos. On n’hésitait pas à retourner contre eux les arguments des militants homosexuels : au nom de la lutte contre les discriminations, les homos souhaitant changer de bord devaient être libre de le faire.
Les deux groupes les plus importants du mouvement « ex-gay » étaient Exodus International, une organisation chrétienne, et Narth, son équivalent laïc. Si Exodus était l’âme de cette coalition, Narth en était le cerveau. Les deux organisations comptaient beaucoup de membres en commun, et Exodus répétait les théories sur l’attraction entre personnes du même sexe promues par Narth.
Avec Charles Socarides, un psychiatre qui s’était opposé au retrait de l’homosexualité de la liste des maladies mentales, Nicolosi a créé Narth en 1992, conçue comme « une organisation scientifique qui redonne espoir à ceux qui subissent une homosexualité non-souhaitée ».
En 1998, le groupe tenait une conférence annuelle, publiait son propre journal et formait des centaines de psychiatres, psychologues et thérapeutes. Nicolosi est resté la figure de proue de Narth.
Invité chez Larry King et Oprah Winfrey
Il n’y a pas de statistiques disponibles sur le nombre de patients qui ont reçu une thérapie ex-gay, ni même sur le nombre de médecins qui l’ont pratiquée, mais à la fin des années 90 et au début des années 2000, ces méthodes n’avaient jamais eu autant de légitimité. Exodus avait 83 sections dans 34 Etats.
Son président, Alan Chambers, déclarait en 2004 qu’il avait connu « des dizaines de milliers de personnes qui avaient réussi à changer leur orientation sexuelle ». Nicolosi a participé à des shows télé populaires, comme ceux d’Oprah Winfrey et de Larry King, ainsi qu’à 20/20, l’émission de reportages d’ABC.
Certes l’alliance de la droite chrétienne et du mouvement ex-gay n’avait pas forcément fait basculer la « guerre des cultures » en cours. Mais elle avait réussi à remettre en cause l’idée que le meilleur choix pour les homosexuels était de s’accepter eux-mêmes.
Après notre première réunion, j’ai discuté au téléphone avec Nicolosi une fois par semaine pendant trois ans, de l’âge de 14 ans jusqu’à ma sortie du lycée. Comme un rabbin apprenant la Torah à son élève, Nicolosi m’incitait à interpréter ma vie quotidienne à la lumière de ses théories.
J’ai lu dans l’un de ses livres, Reparative Therapy of Male Homosexuality (« thérapie réparatrice de l’homosexualité masculine ») qu’il essaie de se placer comme une figure paternelle, créant une relation que, selon lui, ses patients n’ont jamais eu avec leur père. Et c’est vrai c’est ainsi que j’ai peu à peu été amené à le voir.
Nous avons principalement parlé de mon identité masculine endommagée, qui se manifestait par mon attraction pour les autres garçons. Nicolosi me faisait parler des élèves pour qui je ressentais de l’attirance, et ce que j’aimais chez eux. Que j’évoque leur corps, leur apparence, leur popularité ou leur confiance en eux, il concluait toujours en me demandant si je souhaitais avoir moi aussi ces qualités, si j’avais envie que l’un d’eux me donne l’accolade, m’apprécie et m’accepte.
Bien sûr, j’avais envie d’être aussi attirant que les camarades que j’admirais ; bien sûr, je voulais être accepté et aimé par eux. Ces séries de questions me rendaient encore plus malheureux.
Un manque de connexion avec mon père
Nicolosi m’expliquait, séance après séance, que je me sentais en décalage parce que je n’avais pas connu une affirmation masculine suffisante pendant mon enfance. J’en suis venu à croire que mon attraction pour les hommes étaient le résultat d’un manque de connexion avec mon père. A chaque fois que je me sentais repoussé par un ami masculin – parce qu’il ne m’avait pas appelé comme promis, ou parce qu’il ne m’avait pas invité à une fête – je vivais à nouveau le rejet que m’avait fait subir mon père.
La plupart des garçons, me disait-il, ne se laissent pas atteindre par ce genre de choses – parce qu’ils ont confiance en leur masculinité – mais moi, j’étais blessé parce que ça me ramenait à un traumatisme antérieur.
Mes parents ont été surpris par cette interprétation. Au départ, Nicolosi leur avait dit que notre famille faisait figure d’exception, ne collant pas au modèle de la « relation triadique » – en d’autres termes, que mon orientation sexuelle n’était pas de leur faute.
Quand il est devenu clair que Nicolosi les tenait pour responsables, ils se sont désengagés. Ils ont continué de payer pour la thérapie mais n’ont pas vérifié que je suivais les sessions ou demandé de quoi nous parlions. J’étais heureux de défier ainsi mes parents. Ils ne me laissaient pas sortir assez tard ? Ils ne me donnaient pas assez d’argent ? J’avais sous la main une autorité de confiance qui m’assurait que leurs décisions étaient injustes.
N’importe quel désaccord devenait une preuve supplémentaire que mes parents avaient raté mon éducation.
Malgré la thérapie, mes penchants restent
Alors que la thérapie avançait, je sentais que je comprenais mieux les origines de mes penchants. Le problème, c’est qu’ils étaient toujours là. A la demande expresse de Nicolosi, j’ai dit à ma meilleure amie qu’il fallait que je prenne de la distance avec elle. A la place, Nicolosi m’encourageait à créer des « liens authentiques et asexués » avec d’autres garçons.
Il me mit en relation avec un autre de ses patients, Ryan Kendall, qui avait mon âge et vivait au Colorado. Nous discutions régulièrement par téléphone. La plupart du temps, nos conversations étaient banales, nous parlions des gens qu’on aimait et de ceux qu’on n’aimait pas, de nos devoirs et de nos succès à l’école. Une discussion entre deux potes qui devait, selon notre thérapeute, nous réparer.
Mais fréquemment, nous déviions. Nous avons flirté, une expérience nouvelle pour moi ; il n’y avait pas d’homos déclarés dans mon lycée. Nous nous décrivions l’un à l’autre : il disait avoir des cheveux et des yeux bruns, être petit mais mignon ; je disais être grand et maigre (je ne mentionnais pas mes problèmes de peau).
Nous nous sommes promis de nous envoyer des photos, mais nous ne l’avons jamais fait. « Que dirait Nicolosi de tout ça ? », nous demandions-nous. C’est devenu un refrain, notre façon de reconnaître que nous étions en train de mal nous conduire.
Si nous avons pu créer des liens, c’est en partie parce que nous partagions la même rébellion contre notre médecin. Pour moi, c’était moins un rejet de la thérapie ex-gay que le plaisir de défier l’autorité, mais Ryan était convaincu que le changement était impossible – « Nicolosi est un charlatan », m’a-t-il dit un jour.
« Votre fils ne vivra pas comme un homo »
Malgré mes transgressions, je croyais encore aux théories du médecin. Mais ma relation avec Ryan ne m’a pas permis de régler un plus grand problème : alors que je découvrais à quel point la relation avec mes parents avait défini ma vie intime, j’étais toujours attiré par les garçons.
J’ai chatté sur Internet avec des hommes plus âgés, et j’en ai rencontré certains. Je me sentais coupable, mais j’avais assez confiance en Nicolosi pour lui avouer que je faisais « des expériences ». Il m’a dit d’être prudent, mais que je ne devais pas ressentir de la culpabilité ou m’appesantir là-dessus.
Et m’a expliqué que mon comportement sexuel était d’importance secondaire : si je comprenais suffisamment qui j’étais et améliorais mes relations avec les hommes, mes pulsions disparaîtraient d’elles-mêmes. Il fallait juste que je sois patient.
A la fin de ma dernière année au lycée, Nicolosi a eu une ultime conversation avec mes parents et leur a dit que le traitement avait été un succès : « Votre fils ne vivra jamais comme un homo », leur a-t-il assuré. Quelques semaines plus tard, notre femme de ménage m’a surpris avec un garçon dans le jardin. C’était la fin de la thérapie pour moi.
Mes parents étaient convaincus qu’elle n’avait pas marché parce que Nicolosi les avait rendus responsables de mon état. Ils m’ont envoyé voir un autre thérapeute, avec qui j’ai suivi une seule session, refusant de poursuivre avec lui. Même si j’avais accepté la théorie de Nicolosi expliquant pourquoi les gens étaient homos, je considérais que continuer à m’épancher ainsi n’y changerait rien.
Lorsque je suis parti à Yale, ma mère m’a averti : si jamais elle découvrais que je vivais « comme un homo », mes parents ne paieraient plus pour mon éducation. « Je t’aime assez pour t’empêcher de te faire du mal », m’a-t-elle dit.
Une caution scientifique majeure
En 2001, l’année où j’ai commencé l’université, le mouvement ex-gay a reçu un soutien inattendu, celui du professeur et influent psychiatre de Columbia Robert Spitzer, qui avait mené le combat en 1973 pour retirer l’homosexualité de la liste des maladies mentales. Quatre années après les émeutes de Stonewall, à New York, la décision avait été un événement majeur pour les militants des droits des homosexuels.
Mais vingt-huit ans après, Spitzer a publié une étude concluant qu’un changement de l’orientation sexuelle était possible. Basé sur 200 entretiens avec des « ex-gays » – le plus grand échantillon rassemblé jusque là –, elle ne se prononçait pas sur l’efficacité des traitements en question.
Cependant, Spitzer expliquait qu’au moins pour un petit nombre d’individus très motivés, ça avait marché. Ce qui, pour le grand public, est devenu : l’homme à l’origine de la révolution de 1973, qu’on ne pouvait suspecter d’homophobie, a validé le principe de la thérapie ex-gay.
Une dépêche d’Associated Press a qualifié ce travail d’« explosif ». Pour reprendre les mots d’un collègue homo de Spitzer, c’était comme « lancer une grenade dans la communauté gay ». Pour le mouvement ex-gay, c’était du pain bénit. Les autres travaux arrivant aux mêmes conclusions avaient été publiés dans des revues sans contrôle scientifique, dans lesquelles les auteurs paient pour figurer au sommaire, comme Psychological Reports. Le travail de Spitzer était repris dans les prestigieuses Archives of Sexual Behavior.
Cette étude est toujours citée par des organisations ex-gay comme preuve que leurs méthodes ont des résultats. Elle a rendu furieux les militants de la cause gay et beaucoup de psychiatres, qui ont critiqué sa méthodologie et sa forme.
Les participants avaient en effet été adressés à Spitzer par des organisations comme Narth ou Exodus, lesquelles avaient intérêt à lui envoyer des personnes à même de confirmer leurs thèses. On se basait sur leurs seules déclarations, sans comparer les résultats avec ceux d’un groupe de contrôle, ce qui aurait permis d’estimer leur crédibilité.
« Et vous, comment ça s’est terminé ? »
Au printemps, j’ai rendu visite à Spitzer dans sa maison de Princeton. Il est venu m’ouvrir en s’aidant d’un déambulateur. Frêle mais l’esprit toujours vif, Spitzer souffrait de la maladie de Parkinson, « une saloperie ». Je lui ai raconté que Nicolosi m’avait demandé, en 2001, de participer à son étude, comptant mon cas parmi ses réussites. Je ne l’ai jamais rappelé.
« En fait, j’ai eu beaucoup de mal à trouver des participants », se souvenait Spitzer. « Après toutes ces années à pratiquer des thérapies ex-gay, on aurait pu penser que Nicolosi aurait beaucoup de succès à revendiquer. Il ne m’a envoyé que neuf patients. »
« Et pour vous, comment ça s’est terminé ? », a-t-il demandé. J’ai dit que j’étais resté dans le placard quelques années de plus, mais que j’avais fini par accepter mon homosexualité. A la fin de mes études, j’ai commencé à avoir des petits amis stables, et en février – dix ans après ma dernière session avec le docteur Nicolosi –, je me suis marié avec mon partenaire.
Spitzer s’était intéressé aux thérapies ex-gay parce qu’elles étaient controversées – « j’ai toujours été attiré par la polémique » – mais il a été gêné par les réactions que ses conclusions ont déclenchées. Il n’entendait pas prouver que les homos pouvaient entamer des thérapies ex-gay. Son objectif était de déterminer si la proposition inverse – le fait que personne n’aie jamais réussi à changer son orientation sexuelle – était vraie.
Je l’ai interrogé sur les critiques émises contre son travail. « Avec le recul, je dois admettre qu’elles sont en grande parties justifiées », a-t-il répondu. « Ce que j’ai établi, ce n’est rien de plus que ce que disent d’eux-mêmes ceux qui ont suivi un traitement ex-gay. »
Il m’a raconté qu’il avait proposé au rédacteur en chef des Archives of Sexual Behaviour de publier un rectificatif, mais que ce dernier avait refusé (sachant cela, j’ai tenté à plusieurs reprises de joindre ce journal, sans succès).
Il me propose un texte de rétractation
Spitzer m’a confié qu’il était fier d’avoir fait partie de ceux qui ont retiré l’homosexualité de la liste des maladies mentales. Agé de 80 ans, retraité, il avait peur que l’étude de 2001 entache son héritage et fasse souffrir des gens. Il a reconnu que tenter de faire changer d’orientation un homosexuel pouvait « faire des dégâts ».
Mais il n’avait en revanche aucun doute sur la décision prise en 1973. « S’il n’y avait pas eu de Bob Spitzer, l’homosexualité aurait fini par être retirée de cette liste. Mais ça ne serait pas arrivé dès 1973. »
Spitzer commençait à être fatigué, et m’a demandé combien de questions j’avais encore à lui poser. Aucune, ai-je répondu, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter. C’était le cas : il souhaitait que je publie le texte de rétractation proposé à propos de l’étude de 2001, « pour que je n’ai plus à me soucier de ça ».
Au début des années 2000, la caution de Spitzer était d’autant plus précieuse pour le mouvement ex-gay que le besoin de soutiens scientifiques sérieux a commencé à se faire sentir. Un groupe de blogueurs déf